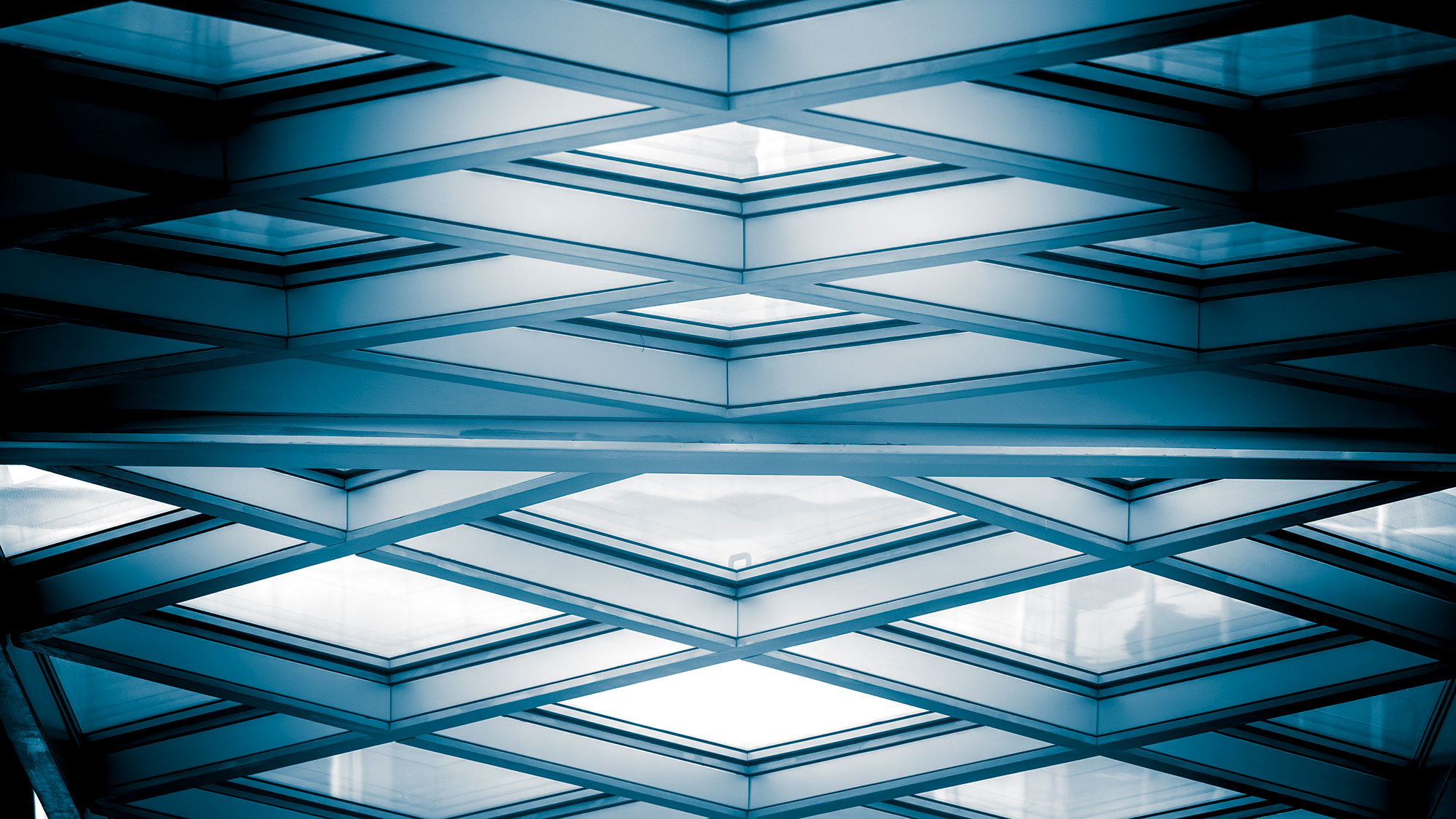
Les actions collectives au Canada : à venir en 2024
En cette fin d’année, Torys se penche sur l’incidence potentielle des décisions de 2023 sur l’avenir des actions collectives au Canada.
Plus de rigueur à l’étape de la certification
Resserrement du critère relatif au meilleur moyen en Ontario
En 2023, dans une décision attendue depuis longtemps, la cour de l’Ontario a examiné pour la première fois sur le fond le nouveau critère du meilleur moyen dans le cadre d’une requête en certification contestée. Comme nous l’avons déjà signalé, le paragraphe 5(1.1) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (la Loi de l’Ontario) a été modifié en 2020 par l’introduction du critère de certification relatif au meilleur moyen qui adopte les critères de supériorité et de prédominance.
Bien que les tribunaux de l’Ontario n’aient fait que mentionner brièvement le nouveau critère relatif au meilleur moyen en 20221, cette année, comme prévu, celui-ci a fait l’objet d’une première interprétation dans l’affaire Banman v. Ontario2. Dans Banman, la Cour a confirmé que le nouveau critère requiert une méthode d’analyse plus rigoureuse, qui consiste à déterminer, à travers le prisme de l’économie des ressources judiciaires, de la modification du comportement et de l’accès à la justice, si les questions communes l’emportent sur les questions individuelles et si le recours collectif proposé est supérieur aux solutions de rechange raisonnables.
Dans les circonstances uniques de l’affaire Banman, qui était une action pour abus intentée contre un établissement, la cour a jugé que le critère relatif au meilleur moyen était atteint. En 2024, nous nous attendons à ce que les tribunaux interprètent ce critère dans d’autres contextes factuels et en considérant des solutions de rechange aux recours collectifs.
Examen plus approfondi à l’étape de la certification
En 2020, nous avons déjà affirmé que la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Atlantic Lottery c. Babstock3 – dans laquelle la Cour a conclu à l’unanimité que la renonciation au recours délictuel n’était pas une cause d’action et la majorité a refusé la certification pour ce motif – permettrait aux tribunaux d’examiner en profondeur le fondement juridique et probatoire des demandes à un stade précoce. Cette année, on constate que nombre de tribunaux ont en effet refusé la certification après avoir appliqué plus rigoureusement le critère de la cause d’action dans les territoires de common law et le critère équivalent au Québec, qui exige que les faits allégués justifient les conclusions recherchées.
Par exemple, dans l’affaire Lewis v. Uber Canada Inc.4, la cour de l’Ontario a refusé la certification d’un recours collectif proposé concernant la taxe sur les produits et services (TPS) payée sur les commandes de repas à prix réduit. La cour a d’abord examiné la nature de la demande et a correctement déterminé qu’il s’agissait d’un recouvrement d’impôts, pour ensuite conclure qu’elle était manifestement irrecevable en raison de l’application de la Loi sur la taxe d’accise et ne satisfaisait pas au critère de l’alinéa 5(1)(a) de la Loi de l’Ontario. Plus récemment encore dans l’affaire Gebien v. Apotex5, un recours collectif proposé contre les fabricants et les distributeurs d’opioïdes, la cour de l’Ontario a estimé qu’il était clair et évident qu’aucune cause d’action raisonnable n’avait été soulevée contre un groupe de distributeurs défendeurs conformément à l’alinéa 5(1)(a), en raison de l’absence de faits importants liant les distributeurs défendeurs aux allégations du demandeur. Le tribunal a également conclu que le demandeur n’avait aucune réclamation juridiquement viable relativement à un objectif commun qui justifierait la responsabilité solidaire des défendeurs, mais qu’il pouvait quand même présenter une réclamation contre 14 groupes de fabricants en joignant un représentant pour chacun de ces groupes et en faisant valoir certaines réclamations fondées sur la loi et le délit de négligence qui satisferaient au critère de la cause d’action (si elles étaient dûment plaidées).
Les tribunaux d’appel ont également confirmé des décisions où la certification avait été refusée après un examen approfondi de la demande. Ainsi, dans l’arrêt Jensen v. Samsung Electronics Co. Ltd.6, la Cour d’appel fédérale a rejeté la prétention des appelants selon laquelle le juge de première instance avait appliqué de façon inappropriée le critère du caractère « évident et manifeste » et avait plutôt procédé à une analyse complète du bien-fondé. La cour s’est plutôt dite entièrement d’accord avec l’approche du juge à l’égard de la certification, qui consiste à examiner rigoureusement la requête ainsi que les allégations, les faits importants et la preuve présentée par le demandeur7. La Cour d’appel du Québec est arrivée à une conclusion semblable dans l’affaire Hazan c. Micron Technology Inc.8, où elle a confirmé que l’examen des allégations à la lumière de la preuve par le juge de première instance n’était pas une analyse du bien-fondé; le juge avait plutôt usé de son pouvoir discrétionnaire pour conclure que les allégations n’avaient pas de fondement factuel et qu’il n’y avait aucune preuve pour constituer une cause défendable.
On peut s’attendre à d’autres décisions semblables en 2024, notamment lorsque les tribunaux se pencheront sur les causes d’actions avancées et les éléments de preuve à l’appui des allégations soulevées. L’arrêt Gebien est particulièrement utile en ce qui concerne les allégations formulées contre les distributeurs d’opioïdes, la cour déclarant que pour des raisons d’ordre public, on ne devrait pas s’attendre à ce que les distributeurs surveillent le commerce illégal de produits pharmaceutiques9. Les tribunaux d’appel devraient fournir d’autres directives à ce sujet en 2024. Par exemple, l’appel de la décision dans l’affaire Frayce v. BMO Investor Line Inc. et al.10, où la cour de l’Ontario avait refusé la certification au motif que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuves d’illégalité, sera entendu en décembre 2023 et une décision est attendue en 2024.
Réserve face aux actions contre des défendeurs étrangers
En 2023, les tribunaux ont précisé l’analyse visant à déterminer la compétence à l’égard d’une action collective proposée contre des défendeurs étrangers en vertu de différents régimes législatifs. En Colombie‐Britannique, la Cour d’appel a récemment confirmé dans l’arrêt Hershey Company v. Leaf11 qu’il faut un seuil minimal de faits attributifs de compétence pour établir une cause défendable selon laquelle les tribunaux de la province ont compétence pour instruire une instance en vertu de la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003 (CJPTA). La cour a conclu que les actes de procédure et la preuve par affidavit présentés par le demandeur n’établissaient pas une cause défendable selon laquelle la procédure concernait un délit commis en Colombie-Britannique en vertu du paragraphe 10(g) de la CJPTA, car ses documents ne respectaient pas les exigences relatives à une allégation de fausse déclaration (qui était la cause d’action invoquée). Citant l’affaire Hershey, la cour de l’Ontario dans l’affaire Gebien a également conclu qu’elle n’avait pas compétence à l’égard d’une entreprise québécoise, Pro Doc, qui revendait des produits opioïdes dans les pharmacies du Québec. Selon la cour de l’Ontario, les deux affaires traitaient de faits semblables, puisqu’il n’y avait aucune représentation faite ou reçue en Ontario attribuable à Pro Doc et que le lien entre Pro Doc, l’affaire, les parties et l’Ontario n’était pas réel et important. La cour a également établi une distinction de forme et de fond avec la décision rendue dans l’affaire British Columbia v. Apotex12, invoquée par le demandeur, dans laquelle on avait conclu que Pro Doc était essentiellement liée à la Colombie-Britannique en tant qu’auteur présumé du délit de complot allégué par le gouvernement provincial. Selon la cour, contrairement à l’affaire Apotex, en l’espèce, il n’y avait pas de lien entre Pro Doc et l’Ontario compte tenu des allégations, puisqu’il n’y avait pas de cause d’action viable contre le groupe de distributeurs défendeurs, dont Pro Doc faisait partie.
En revanche, au Québec, dans l’affaire Bourgeois c. Electronics Arts Inc.13, le tribunal a conclu qu’il avait compétence sur les défendeurs étrangers en vertu de l’article 3148 du Code civil du Québec, qui exige d’établir, prima facie, que le défendeur étranger a un établissement au Québec et que la contestation est relative à leur activité au Québec. Le tribunal a confirmé que la question de savoir si un défendeur a un établissement au Québec est une question de fait. Bien que la notion d’« établissement » ne soit pas définie dans le C.c.Q., un aspect essentiel, particulièrement lorsqu’une société mère étrangère domiciliée hors du Québec sera soumise à la compétence des tribunaux québécois en raison de ses filiales au Québec, consiste à déterminer si la filiale fait partie intégrante de la société mère ou si elle est sous son contrôle immédiat et participe à ses activités. Une filiale (même une filiale détenue en propriété exclusive) ne sera pas, de ce seul fait, visée par la définition d’établissement tant qu’elle sera maintenue comme entité distincte.
Dans l’affaire Bourgeois, le tribunal a conclu que les deux filiales des intimées avaient des activités au Québec qui faisaient partie intégrante de la société mère américaine, formant une entreprise conjointe. En conséquence, le tribunal québécois était compétent, car les sociétés mères étrangères avaient un établissement au Québec en raison de leurs filiales. Les défendeurs étrangers ont fait appel de la décision, faisant valoir que le tribunal de première instance avait incorrectement élargi la définition d’un « établissement » au sens de l’article 3148. L’issue de l’appel est attendue en 2024.
Les tribunaux continueront probablement d’analyser plus en détail le seuil factuel minimal requis pour les demandes contre des défendeurs étrangers et la manière dont ce seuil varie selon les différents régimes législatifs provinciaux. Notamment, si la Cour d’appel du Québec confirme la décision dans l’affaire Bourgeois, on pourrait voir une augmentation des réclamations contre les sociétés étrangères ayant des filiales avec des activités au Québec.
Approche plus stricte à l’égard du rejet pour cause de retard
Les tribunaux continuent de rejeter les recours collectifs proposés pour cause de retard en vertu de l’article 29.1 de la Loi de l’Ontario et en vertu des règles de pratique dans d’autres territoires. Comme nous l’avons déjà signalé, l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par l’article 29.1 a fait l’objet d’une attention judiciaire importante. Dans l’affaire Tataryn v. Diamond & Diamond Lawyers LLP14, la cour a reconnu le débat jurisprudentiel sur la question de savoir s’il y a matière à interprétation de ce qui constitue les mesures en vue de la certification énumérées aux alinéas (a) à (d) de l’article 29.1, mais elle a statué que, néanmoins, le libellé est impératif et qu’une action doit être rejetée s’il est clair qu’aucune des mesures prévues n’est prise à temps.
Dans l’affaire Tataryn, la cour s’est également penchée sur la question de savoir si la défenderesse avait renoncé aux droits que lui confère l’article 29.1 en présentant des requêtes pré-certification et en attendant longtemps avant de présenter sa requête en rejet pour cause de retard. La cour a confirmé que l’article 29.1 ne peut faire l’objet d’une renonciation, car il s’agit d’une disposition d’intérêt public et qu’elle confère aux défendeurs des droits auxquels ceux-ci ne peuvent renoncer théoriquement en présentant des requêtes qui ont gain de cause.
Elle a également examiné l’« ordonnance phénix » accordée dans l’affaire D’Haene v. BMW Canada Inc.15, où le tribunal avait rejeté l’action, mais avait autorisé l’introduction d’une nouvelle action. La cour a conclu qu’une telle ordonnance irait directement à l’encontre de l’objectif d’intérêt public de l’article 29.1 et ne réglerait pas le problème que celui-ci cherche à prévenir. La cour a également laissé entendre que ressusciter un cas identique après un rejet pour cause de retard pourrait constituer un abus de procédure, mais n’a pas rendu de décision sur cette question.
À l’extérieur de l’Ontario, les tribunaux ont également appliqué strictement leurs règles de pratique à l’égard de délais trop longs dans les actions collectives proposées. En Saskatchewan, les défendeurs dans l’affaire Bovier v. Crary Company16 ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action collective proposée en vertu de la règle 4-44 des Règles de la Cour du Banc de la Reine en raison d’un retard excessif et inexcusable. Le tribunal a conclu qu’il y avait eu un retard excessif et inexcusable, et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de laisser la demande suivre son cours.
Nous nous attendons à ce que les tribunaux continuent de fournir des précisions sur l’approche appropriée à l’égard du rejet pour cause de retard des actions collectives proposées, que ce soit en vertu de cadres législatifs précis ou des règles de pratique.
Points à retenir pour les entreprises
Nous nous attendons à de nombreux développements dans le domaine des actions collectives en 2024. Voici les principaux points à retenir pour les entreprises :
- Les tribunaux examinent plus rigoureusement les allégations et les éléments de preuve présentés par les demandeurs à l’étape de la certification. Il s’agit d’une tendance positive pour les défendeurs qu’on doit continuer de surveiller de près.
- La Cour de l’Ontario a confirmé que le nouveau critère du meilleur moyen exige une approche analytique plus rigoureuse et est plus difficile à satisfaire. Bien que ce critère ait été satisfait dans le contexte unique d’abus institutionnels, on s’attend à des développements importants en Ontario relativement à son interprétation dans d’autres contextes factuels et à la considération de solutions de rechange.
- Au moment de déterminer leur compétence territoriale à l’égard de défendeurs étrangers, les tribunaux exigeront un fondement probatoire minimal et tiendront principalement compte du régime législatif applicable. Lorsqu’elles évaluent le risque lié aux actions collectives, les entreprises, particulièrement celles dont les sociétés mères se situent en dehors du Canada, devraient tenir compte des différences entre les régimes législatifs.
- En 2023, les tribunaux de l’Ontario ont indiqué qu’ils adopteraient une approche plus stricte à l’égard du rejet pour cause de retard prévu par la Loi de l’Ontario. Ils ont aussi fourni des précisions sur la renonciation à cette disposition et sur les « ordonnances phénix ». D’autres tribunaux ont également utilisé leurs règles de pratique pour rejeter des actions collectives pour cause de retard. Ces décisions sont utiles aux défendeurs et indiquent que les tribunaux n’hésiteront plus à adopter des approches plus strictes à l’égard des retards dans le cadre d’actions collectives.
- Voir Brewers Retail v. Campbell, 2022 ONSC 850.
- 2023 ONSC 6187. Notre article précédent est accessible ici.
- 2020 SCC 19.
- 2023 ONSC 6190.
- 2023 ONSC 6792 [Gebien].
- 2023 FCA 89. Notre article précédent est accessible ici.
- 2023 FCA 89, paragr. 49.
- 2023 QCCA 132.
- Gebien, paragr. 410.
- 2023 ONSC 16.
- 2023 BCCA 264.
- 2023 BCSC 662.
- 2023 QCCS 1011.
- 2023 ONSC 6165.
- 2022 ONSC 5973.
- 2023 SKKB 21.
Si vous souhaitez discuter ces enjeux et ces questions, veuillez contacter les auteurs.
Cette publication se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, c'est avec plaisir que nous discuterons les questions soulevées dans cette communication avec vous, dans le cadre de votre situation particulière.
Pour obtenir la permission de reproduire l’une de nos publications, veuillez communiquer avec Richard Coombs.
© Torys, 2026.
Tous droits réservés.


